Tristan Hordé on « Le dernier cerisier » / Sitaudis
- Post By: johntaylor
- Date:
- Category: News
Tristan Hordé has written this fine article about Le dernier cerisier (Éditions Voix d’encre; watercolors by Caroline François-Rubino; translated by Françoise Daviet-Taylor) for the literary website Sitaudis:
La quatrième de couverture présente le livre comme une « méditation sur le temps » ; il serait possible de réunir en un fort volume des poèmes autour de ce motif, que l’on se limite au domaine français — ou anglais, puisque John Taylor a écrit dans sa langue, mais rien de convenu dans les trois poèmes (le premier donnant son titre à l’ensemble) qui revisitent heureusement un des fondements du lyrisme.
Comment vivre le temps ? C’est peut-être dans le second poème, suite de variations sur l’expression À jamais que John Taylor l’exprime le plus nettement. Ce qui a été vécu l’est sans retour — à jamais—, mais chacun peut l’évoquer, le répéter. Les éléments dispersés du passé apparaissent alors comme un ensemble continu, parce que tout ce qui est derrière soi devient proche grâce à la mémoire et tout autant à l’imagination. Ce sont des paysages qui demeurent présents, ici ceux de la neige de l’enfance avec toutes les sensations qui y demeurent attachées. Avec les lieux de l’enfance revient, très fortement, l’image de la mère ; d’une certaine manière, le temps vécu s’organise à partir d’elle, elle est à la fois la figure du commencement (par « l’accouchement ») et la fin (par « sa mort »).
La mère est aussi présente dans le premier poème. La représentation du cerisier, arbre présent ou non, réel ou non, ramène vers la mère et vers d’autres horizons, comme la culture japonaise. L’arbre, sans lieu assigné, est perçu comme une sorte de « témoin » de tout ce qui se passe, chargé symboliquement du passé, de tout ce qui n’est plus. Il change au fil des saisons, quelle que soit sa place, tout comme l’homme (« où que tu sois / est ton pays natal ») ; chargé de fruits ou avec ses « branches nues » l’hiver, il est l’image même de ce qui change en restant le même, indépendamment de qui le regarde. C’est bien ainsi que la vie se passe pour l’homme, bien peu de ce qui se vit lui est connu (« tant d’autres choses / qui avaient eu lieu / qui ont lieu / sans toi »). Le cerisier, comme les fruits qu’il porte, comme les souvenirs, comme la reconstruction du passé, a d’abord une existence grâce aux mots, « il s’élève dans ton esprit / sur cette feuille de papier / sur cette page ». Il est élément d’un récit destiné à évoquer le changement des choses du monde.
C’est ce changement, minuscule mais qui se répète quotidiennement, avec le passage du jour à la nuit, qu’explore le dernier poème. John Taylor se souvient de la lente disparition du jour « au-dessus de la neige » : le temps semble s’arrêter alors qu’il n’est pas, ailleurs, de transition entre lumière et obscurité. Il retient ce qui se passe avec les arbres : ils restent visibles malgré la venue de la nuit et qui les regarde a l’impression qu’ils « portent de la lumière / un sombre et soudain réconfort ». Pendant ce temps, avant que tout devienne immobile, ce qui est encore perçu donne à imaginer ce que sera l’absence, figure ce que peut être aussi la nuit intérieure.
Ces mouvements de la mémoire et des mots vers le passé sont accompagnés d’aquarelles qu’on penserait aisément être le point de départ de l’écriture, tant les mots paraissent en dire les formes et les couleurs. Pour le premier poème, Caroline François-Rubino propose des silhouettes du cerisier, l’une, grise, emplit la page, d’autres sont disposées à des places différentes, plus ou moins en retrait, jusqu’à n’être plus qu’une branche, puis une ombre. Les autres poèmes excluaient toute représentation nette, et dans les nombreuses images bleues ou grises, on imagine des paysages resurgis du passé, la nuit qui approche. L’association du peintre et de l’écrivain aboutit à une méditation réussie sur le temps, chacun à sa manière mettant en relief une des caractéristiques du lyrisme, la répétition.
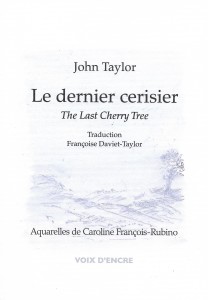
Laisser un commentaire