Une estampe : voilà le mot qui vient à l’esprit lorsqu’on referme le recueil de John Taylor, Le dernier cerisier, traduit par Françoise Daviet-Taylor et illustré par Caroline François-Rubino. Une estampe, parce que tout dans cet ouvrage en a la finesse. Les aquarelles sont le parfait miroir des émotions que génère l’univers textuel, avec, d’abord, d’imprécises silhouettes d’arbres qui se fondent dans le gris bleuté d’un paysage vague ; puis viennent des teintes plus soutenues, et des touches de noir tantôt hérissées comme des scarifications, tantôt étendues aux côtés de larges trouées blanches ; viennent enfin des paysages de neige semés de minuscules motifs sombres semblables à d’énigmatiques présences.
Les mots, quant à eux, sont porteurs d’évocations délicates. Il y a le cerisier, bien sûr, ce « témoin de tout et de tous » dont la réalité échappe, dont la « matière » se confond avec celle de « nos vies » et les silences dans la mémoire, et qui convoque la vision d’une « femme en kimono » tendrement mêlée à la « douce image » de la mère.
Il y a aussi les champs et les espaces qui deviennent des « jardins secrets »… Et il y a surtout la neige, qui a éveillé la peau aux sensations vives de « froid » et d' »humidité », qui a paré de gel et de givre les « longs hivers » de l’enfance, et donné la dimension du rêve et de l’infini — infini du cosmos « sans bornes » perceptibles, et infini du temps qui déroule ses étapes, ses « auparavant », « maintenant », « plus tard », ses « jamais » et ses « lointains »…
Comme l’eau de l’aquarelliste qui dilue les couleurs pour les fondre dans un ensemble, la neige harmonise dans un même « miroitement » la blancheur des pétales, de la glace, du froid, et de la mort, l’opacité du crépuscule et celle de la brume, les élancements du souvenir et ceux du non-accompli. Sa lumière compose avec l’obscurité de la nuit un « linceul noir » où « persistent » des silhouettes d’arbre.
Cette « lumière ourlée de noir » est celle du paysage intérieur, à la fois dévasté et rayonnant, la nuit y peut tomber « en plein jour » et la clarté y est à la fois « sombre » et « chaude ». Dans ce contexte, le texte original en anglais, qui prend la suite de la traduction en français, apparaît comme le point d’orgue nécessaire au « souviens-t’en » des dernières pages : une reprise nuancée, une remontée aux sources, une saisie du « temporaire » qui reprend vie et sens à la faveur d’une réminiscence.
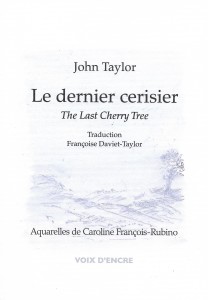
Laisser un commentaire